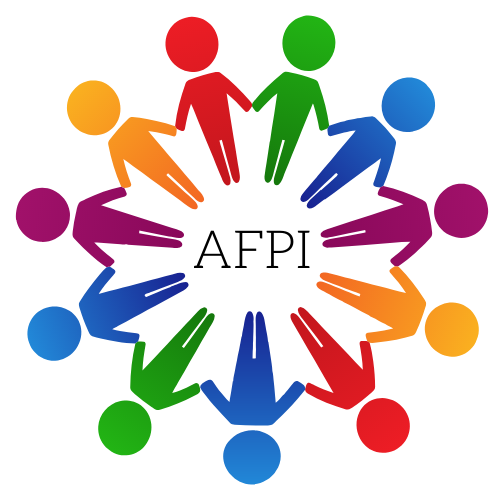Lorsqu'un couple se sépare, la question de la prestation compensatoire revient fréquemment au cœur des débats judiciaires. Ce mécanisme, prévu par le Code civil français, vise à compenser la disparité financière que le divorce peut créer entre les deux anciens époux. Pourtant, il arrive que le juge aux affaires familiales refuse d'accorder cette compensation. Plusieurs critères déterminent une telle décision, et il est essentiel de comprendre les raisons qui conduisent à un refus d'attribution de prestation compensatoire. Cet article propose une analyse détaillée des motifs invoqués par la jurisprudence et des situations concrètes où le juge considère que cette prestation n'a pas lieu d'être.
L'absence de disparité dans les conditions de vie après le divorce
L'un des fondements essentiels de l'octroi d'une prestation compensatoire réside dans l'existence d'une disparité financière marquée entre les deux ex-époux. L'article 270 du Code civil précise que cette prestation a pour vocation de compenser la rupture d'équilibre économique générée par le divorce. Lorsque cette disparité n'est pas avérée ou qu'elle demeure trop faible, le juge peut tout simplement refuser d'accorder la compensation demandée. Il ne suffit pas qu'un époux gagne légèrement plus que l'autre : la différence doit être significative et justifier un rééquilibrage financier réel. Dans la pratique, un écart de revenus inférieur à vingt pour cent entre les deux conjoints peut conduire à un refus d'attribution. Par exemple, la Cour d'appel de Paris a considéré en 2022 qu'un couple dont les revenus respectifs s'élevaient à 5200 euros et 4800 euros ne présentait pas une disparité suffisante pour justifier une prestation compensatoire. Cette proximité de revenus laisse présumer que chacun dispose d'une capacité financière similaire pour faire face à ses besoins après la séparation.
L'équilibre des ressources financières entre les ex-époux
Au-delà de la simple comparaison des salaires, le juge examine l'ensemble des ressources dont disposent les parties. Il ne se contente pas d'analyser les revenus du travail, mais prend également en compte les revenus du patrimoine personnel, les placements financiers et les biens immobiliers. Si les deux époux bénéficient de sources de revenus diversifiées et comparables, l'idée même d'une disparité s'efface. Dans certaines affaires, la Cour de cassation a souligné en 2019 qu'un demandeur pouvait avoir des revenus inférieurs à ceux de son ex-conjoint, mais posséder un patrimoine immobilier ou des placements qui rendaient sa situation financière globalement équilibrée. Cette vision globale de la situation patrimoniale permet d'éviter qu'un époux qui dispose de ressources solides ne demande une compensation financière injustifiée. Le principe d'équité guide alors la décision du juge, qui cherche à éviter tout enrichissement sans cause.
La capacité professionnelle comparable des deux parties
L'évaluation de la capacité professionnelle des deux époux constitue un autre élément déterminant. Le juge s'intéresse aux qualifications professionnelles, aux diplômes obtenus, à l'expérience accumulée et aux perspectives d'évolution de carrière. Lorsque les deux parties présentent des profils professionnels équivalents, avec des possibilités d'emploi similaires, le refus de la prestation compensatoire devient probable. L'autonomie financière démontrée au moment du divorce joue un rôle central dans cette appréciation. Un époux jeune, diplômé et en bonne santé, ayant conservé une activité professionnelle durant le mariage, aura davantage de difficultés à convaincre le juge qu'une compensation est nécessaire. La jurisprudence insiste sur le fait que chaque partie doit assumer ses responsabilités économiques après le divorce, sauf si le mariage a véritablement entravé le développement professionnel de l'un des conjoints.
La durée trop courte du mariage comme motif de rejet
Le temps passé ensemble en tant qu'époux constitue un critère d'appréciation majeur dans l'examen d'une demande de prestation compensatoire. Les juges considèrent que plus un mariage a été long, plus il a pu avoir un impact sur les choix professionnels et patrimoniaux des conjoints. À l'inverse, un mariage de courte durée limite les conséquences économiques de l'union. Lorsque les époux se sont séparés après quelques années seulement, le juge peut estimer que le lien conjugal n'a pas eu le temps de créer une véritable interdépendance financière. La brièveté du mariage devient alors un argument solide pour refuser la prestation compensatoire. La Cour de cassation a, par exemple, validé en 2008 le rejet d'une demande dans le cadre d'un mariage qui avait duré seulement quatre ans, sans que celui-ci n'ait eu d'impact notable sur les carrières professionnelles des deux parties.
Le seuil minimal de durée apprécié par la jurisprudence
Bien qu'il n'existe pas de seuil légal précis, la pratique judiciaire révèle qu'un mariage de moins de cinq ans est souvent considéré comme trop bref pour justifier une prestation compensatoire. Cette règle n'est toutefois pas absolue. Des circonstances exceptionnelles peuvent faire pencher la balance en faveur du demandeur, notamment en cas de maladie grave survenue pendant le mariage ou de sacrifice professionnel consenti par l'un des époux pour soutenir l'autre. Mais en l'absence de telles particularités, la brièveté de l'union demeure un obstacle quasi-insurmontable. Les juges estiment qu'une période de cohabitation réduite ne suffit pas à créer une dépendance économique durable, et que chaque époux conserve une capacité d'autonomie qu'il avait avant le mariage.
L'impact limité du mariage sur la situation patrimoniale
Le juge évalue également si le mariage a réellement modifié la situation patrimoniale et professionnelle des époux. Lorsque les deux conjoints avaient déjà une autonomie financière avant de se marier et qu'ils ont conservé leurs activités professionnelles respectives pendant l'union, l'impact du mariage sur leurs conditions de vie reste limité. Dans ce cas, il devient difficile d'invoquer une rupture d'équilibre causée par le divorce. La prestation compensatoire n'a pas vocation à redistribuer la richesse entre deux personnes qui ont mené des vies économiques parallèles et indépendantes. Les juges insistent sur le fait que le mariage doit avoir entraîné des conséquences tangibles sur la trajectoire de vie de l'un des époux pour que la compensation soit justifiée. Si aucun choix professionnel majeur n'a été sacrifié, si aucun projet de carrière n'a été abandonné, alors le refus de la prestation s'impose logiquement.
Le comportement fautif du demandeur pris en compte par le juge

Depuis la réforme de 2004, le comportement des époux durant le mariage et lors de la procédure de divorce peut influencer la décision du juge concernant la prestation compensatoire. Si le principe de non-faute a été renforcé dans le droit du divorce, il subsiste néanmoins des situations où la conduite de l'un des époux peut justifier un refus de compensation. Seuls les comportements ayant un impact patrimonial direct sont désormais pris en compte. Il ne s'agit plus de sanctionner les torts moraux, mais de réagir face à des actes qui ont compromis l'équité financière au sein du couple. Un comportement frauduleux ou une attitude de mauvaise foi dans la gestion du patrimoine commun peuvent ainsi constituer un motif de refus. La Cour de cassation a rappelé en 2017 que, dans certaines circonstances, un comportement grave rendait l'attribution d'une prestation compensatoire manifestement inéquitable.
La mauvaise foi dans la gestion du patrimoine commun
Lorsqu'un époux dissimule des revenus, dilapide des biens communs ou organise frauduleusement son insolvabilité avant le divorce, le juge peut refuser de lui accorder une prestation compensatoire. La dissimulation de revenus constitue une faute grave qui entache la crédibilité du demandeur et remet en cause le fondement même de sa demande. Comment justifier une compensation financière si les ressources réelles n'ont jamais été honnêtement déclarées? Le juge aux affaires familiales dispose de moyens d'investigation pour vérifier la sincérité des déclarations de revenus et de patrimoine. En cas de doute, il peut ordonner des mesures d'instruction pour établir la vérité. Les manœuvres dilatoires ou les tentatives de fraude sont sanctionnées par un rejet de la demande, au nom de l'équité et de la bonne foi qui doivent régir les relations entre ex-époux.
Le refus volontaire de travailler ou de se former
Un autre motif de refus fréquemment invoqué concerne l'inertie volontaire du demandeur. Si l'un des époux refuse de chercher un emploi, de se former ou de valoriser ses compétences professionnelles, le juge peut considérer que cette personne ne fait pas les efforts nécessaires pour assurer son autonomie financière. La Cour d'appel de Versailles a ainsi rejeté en 2021 la demande d'une épouse de quarante-huit ans, diplômée, qui n'avait entrepris aucune démarche de recherche d'emploi après le divorce. Cette décision repose sur le principe que chaque époux doit assumer une part de responsabilité dans la reconstruction de sa vie économique. La prestation compensatoire n'a pas pour vocation de pallier la passivité ou le désintérêt professionnel de l'un des conjoints. Elle doit venir en aide à celui qui, malgré ses efforts, ne parvient pas à retrouver un équilibre financier en raison des conséquences du mariage. Le refus volontaire de se réinsérer sur le marché du travail constitue donc un obstacle majeur à l'obtention d'une compensation.
Les ressources suffisantes du conjoint demandeur
Lorsque le demandeur dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins, le juge estime que l'attribution d'une prestation compensatoire n'est plus justifiée. Cette situation se rencontre notamment lorsque l'époux concerné possède un patrimoine immobilier conséquent, des placements financiers ou des revenus locatifs qui lui assurent une sécurité matérielle. L'objectif de la prestation compensatoire est de compenser une disparité, non de créer un déséquilibre supplémentaire en enrichissant l'un des ex-époux. Le juge doit donc procéder à une évaluation minutieuse de l'ensemble des ressources du demandeur, en tenant compte non seulement des revenus professionnels, mais aussi de tous les éléments du patrimoine personnel. Même en présence d'un écart de revenus entre les deux époux, la prestation peut être refusée si le demandeur bénéficie d'une situation patrimoniale globalement favorable.
L'autonomie financière démontrée au moment du divorce
L'autonomie financière constitue un critère d'appréciation central. Si, au moment du divorce, l'un des époux dispose déjà d'une indépendance économique solide, il devient difficile de justifier l'octroi d'une compensation. Cette autonomie peut résulter d'un emploi stable et rémunérateur, d'un patrimoine constitué avant le mariage ou encore de perspectives professionnelles prometteuses. Un époux jeune, en bonne santé, sans charges familiales et disposant de qualifications reconnues sera généralement considéré comme autonome. Dans ce contexte, le juge estime que la personne concernée peut assumer seule les conséquences économiques du divorce sans qu'il soit nécessaire de solliciter une aide financière de son ancien conjoint. Le principe d'équité guide alors la décision, en cherchant à éviter qu'un époux en bonne position économique ne tire profit du divorce pour obtenir un avantage financier supplémentaire.
Les revenus du patrimoine personnel et les perspectives d'emploi
Le juge analyse également les revenus tirés du patrimoine personnel, tels que les loyers, les intérêts de placements ou les dividendes. Ces éléments peuvent transformer radicalement l'évaluation de la situation financière d'un demandeur. Un époux dont les revenus salariaux sont modestes, mais qui perçoit des revenus locatifs réguliers, ne se trouve pas dans une situation de précarité financière. La Cour de cassation a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises l'importance de cette vision globale. En 2019, elle a validé le refus d'une prestation compensatoire pour un demandeur dont les revenus professionnels étaient certes inférieurs à ceux de son ex-conjoint, mais qui possédait un patrimoine immobilier lui assurant une sécurité matérielle. Par ailleurs, les perspectives d'emploi jouent également un rôle déterminant. Un époux qui dispose de qualifications professionnelles recherchées et de réelles opportunités sur le marché du travail sera jugé capable de rebondir économiquement après le divorce. Le refus de la prestation s'inscrit alors dans une logique de responsabilisation et d'encouragement à l'autonomie.